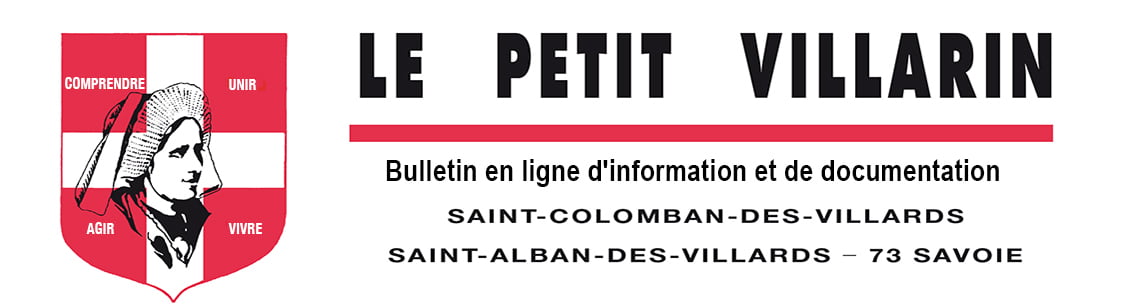Cérémonie du 14-Juillet aux Villards : valeurs républicaines et rôle des communes mis au centre des allocutions
La fête nationale a été célébrée par une cérémonie au monument aux morts des deux communes en présence des responsables de l’Association des anciens combattants et victimes de guerre de la vallée des Villards, d’une soixantaine de personnes à Saint-Colomban, une cinquantaine à Saint-Alban. La dernière cérémonie, organisée à Saint-Colomban-des-Villards, a été suivie d’un apéritif pris à l’Hôtel de la poste. Le protocole ne prévoit pas de discours officiels à lire pour les célébrations de la fête nationale, ni du ministre des armées, ni des associations nationales des anciens combattants. Comme l’a indiqué Jacqueline Dupenloup en préambule de son intervention, ce jour-là les maires sont « en figure libre pour leur propos » et s’adressent à la population comme ils l’entendent.

Dans son allocution, à Saint-Colomban-des-Villards, Pierre-Yves Bonnivard (lire ci-dessous) a choisi de mettre en avant la « situation politique nationale complexe et un contexte international dégradé, proche d’une instabilité croissante » invitant tout un chacun à rendre « hommage à l’ordre public républicain et à ceux qui veillent sur lui. Rendons également hommage à tous ceux qui assurent le fonctionnement du pays, malgré les situations de crise que nous voyons se succéder. »


■ De gauche à droite : Gilbert Émieux, Daniel Quézel-Ambrunaz, Sébastien Sornet, Patrick Louadoudi. – (Photos Patrice Gérard.)
À Saint-Alban-des-Villards, Jacqueline Dupenloup (lire ci-dessous) a axé ses propos sur « nos actuelles communes » qui sont nées « du bouillonnement de ces années-là », et sur le fait que « la révolution républicaine, en moins de 10 ans, a donné à la France des valeurs et des institutions qui la structurent encore au XXIe siècle ».
Le maire de Saint-Alban a terminé son discours en indiquant à propos de la devise républicaine (liberté, égalité, fraternité) : « Aucun des trois termes ne va sans l’autre, mais je vais quand même en privilégier un en vous parlant de fraternité, celle qui se construit dans l’échange, les rencontres, la connaissance des autres. » Et de rappeler les animations programmées dans sa commune jusqu’à la fin juillet comme « plusieurs temps de rencontres et d’échanges ».
Allocution de Pierre-Yves Bonnivard
Rendons hommage à l’ordre public républicain
Villarins, Villarinches, chers concitoyens,
Nous voici aujourd’hui rassemblés, comme tous les 14 juillet, pour célébrer notre fête nationale, moment important de l’année. Il en est ainsi depuis le 6 juillet 1880, année où la IIIe république en a pris la décision. C’est une référence au 14 juillet 1789, la prise de la Bastille et surtout au 14 juillet 1790, La Fête de la Fédération, symbole de l’union de la Nation.
Partout en France, aujourd’hui, il y aura des moments de fête, malgré une situation politique nationale complexe, et un contexte international dégradé, proche d’une instabilité croissante.
Notre présence devant le monument aux morts de notre commune est aussi un rappel à la vigilance. La liberté durement acquise et chèrement défendue au fil des siècles est sans cesse remise en question. Des évènements tragiques ont encore ponctué l’année qui vient de s’écouler, sur notre territoire national et surtout dans le monde : par exemple, la guerre en Ukraine qui se poursuit ; les conflits au Proche-Orient ; des peuples persécutés sur la majorité des continents, qui cherchent à survivre ; des démocraties remises en cause ; des peuples qui ne connaissent pas la paix.
L’État continue de préserver notre sécurité et surtout les valeurs qui font l’identité de la France et le modèle qu’elle représente. Rendons donc hommage à l’ordre public républicain et à ceux qui veillent sur lui. Rendons également hommage à tous ceux qui assurent le fonctionnement du pays, malgré les situations de crise que nous voyons se succéder.
La République est notre bien commun. Elle est la garante de notre unité et de notre liberté. En elle, cohabitent les différences qui font la force de notre pays. Mais nous devons tenir une position claire qui aille dans le sens de l’intérêt général et qui respecte chacun d’entre nous, sans jugement, sans rejet de l’autre, mais avec plus de cohérence, plus de justesse, plus d’égalité et plus de fraternité. Cette cohésion est aussi indispensable pour faire face aux menaces extérieures qui pèsent sur notre pays et notre Nation.
La République, la Ve que nous connaissons, est-elle encore adaptée à notre monde et à notre société actuelle ? La Constitution de 1958, qui régit notre organisation politique, avec le rôle majeur du président de la République, reste-t-elle d’actualité ? De nombreuses questions se posent, mais que ce 14 juillet 2025 soit comme il l’a toujours été, un moment de partage dans la liberté, l’égalité et la fraternité.
Vive Saint-Colomban-des-Villards !
Vive la République ! Vive la France !
Pierre-Yves Bonnivard
Allocution de Jacqueline Dupenloup
L’attachement à la commune, cellule de base de la vie républicaine, demeure
C’est en 1880, sous la IIIe République, que le jour du 14 juillet a été choisi comme fête nationale, en référence au 14 juillet 1790, où eut lieu à Paris la fête nationale de la Fédération pour célébrer l’unité des Français venus de toutes les provinces, en présence du roi Louis XVI qui prêta serment à la Nation et à la loi. Mais à l’évidence, lorsque la question est posée en 2025 dans la rue aux citoyens français, la réponse spontanée et majoritaire est : le 14 juillet, c’est la prise de la Bastille en 1789. Prise de la Bastille, symbole mythique d’une Révolution française qui, ensuite, en 1792, décrète à l’unanimité le 21 septembre l’abolition de la royauté, marque le 22 septembre comme premier jour de la République, et déclare le 25 septembre la République française « une et indivisible ». La révolution républicaine, en moins de 10 ans, a donné à la France des valeurs et des institutions qui la structurent encore au XXIe siècle. C’est du bouillonnement de ces années-là que sont nées nos actuelles communes.
Avant la Révolution, il y avait principalement les paroisses, divisions religieuses, mais aussi les seigneuries, et les communes pour certaines grandes villes ayant acquis au Moyen-âge une certaine liberté par rapport à un seigneur ou même au roi. Peu ou pas de démocratie dans ces entités. Le poste de maire pouvait être simplement acheté dans certaines grandes cités. Dans les petites paroisses, le conseil de fabrique était destiné à gérer principalement les biens religieux. Pour la seigneurie, seul le seigneur décidait. Sur une même paroisse, on pouvait avoir plusieurs seigneuries avec parfois des lois différentes, ce qui rendait les choses très compliquées et forcément inéquitables.
Le 12 novembre 1789, l’Assemblée nationale constituante décrète « qu’il y aura une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne ». La commune devient la cellule administrative de base. La loi unifie le statut de ces entités territoriales, avec une délimitation largement reprise de celle des 44 000 paroisses issues du Moyen-Âge et de la monarchie. C’est ainsi qu’est officialisé le mouvement d’autonomie communale révolutionnaire. Tout ce qui reste de pouvoir féodal ou corporatif sur le pouvoir municipal est aboli par la Révolution de 1789. Ni les seigneurs, ni les évêques, ni les chefs de corporation ne peuvent plus désigner les officiers municipaux, ou assister de droit aux assemblées municipales. Les conseils municipaux sont élus au suffrage censitaire (pour être électeur, il faut payer un certain niveau d’impôt, équivalent à 3 journées de travail, seuil assez peu élevé) et élisent un maire. Des « maisons communes », les mairies, sont construites pour accueillir les réunions du conseil et l’administration municipale.
L’élection des conseils municipaux se fera au suffrage universel direct de façon définitive en 1882, avec cependant une période d’interruption entre 1940 et 1945 puisque le gouvernement de Vichy pratiquera la nomination des maires par le gouvernement. Suffrage universel direct en 1882, mais, n’exagérons rien quand même, sans le vote des femmes. Il fallut attendre 1945 pour que le droit de vote leur soit accordé en France, leur place dans les mouvements de résistance n’étant sans doute pas étrangère à cette évolution. Aujourd’hui, en 2025, soit 236 ans après, le nombre de communes est passé de 44 000 à 34 875. La création de communes nouvelles par fusion de communes n’est pas si rapide qu’escomptée par la loi de 2015. L’attachement à la commune, cellule de base de la vie républicaine, demeure.
Cette constitution des communes était soucieuse d’un traitement égal devant la loi de tous les citoyens de France, soucieuse d’une participation large à la vie municipale, soucieuse d’éviter une coupure entre élus et électeurs, soucieuse du non cumul des mandats. Elle portait en elle le respect des citoyens. Ainsi, dans les plus petites communes, on faisait appel à eux pour désigner et contrôler les gestionnaires du territoire, pour gérer les territoires. Ainsi, l’éducation civique des citoyens se concrétisait, devenait vivante : « Voici votre lieu de vie, que voulez-vous qu’il soit, que voulez-vous qu’il devienne. Dans le cadre de la loi, mais qui se veut la même pour tous, c’est à vous d’agir. La République vous le demande et vous attribue sa confiance, à vous citoyens de base. À partir de 1945, à vous citoyennes aussi. »
Remarquable, extraordinaire principe républicain. Il faut en connaître la valeur, il faut aussi en mesurer la difficulté. D’autant que si, en 1789, le mandat électif communal était de deux ans, il est maintenant, vous le savez, de 6 ans… c’est long, 6 ans. C’est, pour ceux qui gèrent pour un temps les affaires communales, bien sûr, beaucoup d’engagement. Je veux saluer ici l’ensemble des élus qui au fil des ans se sont impliqués dans la gestion de notre petite commune de Saint-Alban-des-Villards, avec leur savoir, avec leur connaissance du terrain, avec leurs efforts pour s’adapter aux contraintes des horaires de réunions, des lectures de documents, des réflexions et des analyses. Ce savoir, cette culture de proximité sont indispensables pour faire vivre un pays.
Nous ferons en 2025, comme à l’accoutumée, une réunion publique sur l’activité et les travaux municipaux. Les évolutions intercommunales seront présentées aussi, car il est important que ce qui devrait être mutualisation et solidarité entre communes ne vienne pas fausser l’idéal de citoyenneté de la République. L’information et le débat sont nécessaires sur ces évolutions.
Je voudrais conclure cette partie de mon propos sur une note plus personnelle. Je vais achever bientôt mon second mandat de maire. Merci à Nicole Roche et Annie Bordas qui ont été toujours disponibles pour la commune durant ces 11 et bientôt 12 années, nous avons fait pendant deux mandats un vrai trio. Nos réalisations, nos actions, vous ont peut-être convenu, ou peut-être pas. Il a fallu parfois dire non à certaines demandes, certaines propositions, ou bien le manque de temps ou de moyens a fait que nous n’y avons pas répondu. Mais je peux vous garantir que j’ai toujours eu en tête le principe républicain : chaque citoyen a droit au respect, chaque voix devrait être entendue. J’espère simplement que vous l’avez compris.
Jacqueline Dupenloup
_________________________________________________________
■ Photo de « Une » : Jacqueline Dupenloup et Pierre-Yves Bonnivard. – (Photo Patrice Gérard.)