Quelle transition pour le tourisme villarin ?
Les difficultés économiques récurrentes rencontrées par Saint-Colomban-des-Villards dans la gestion de son domaine skiable, ont conduit les services de la préfecture de la Savoie à apporter à la commune des moyens en ingénierie pour « l’accompagner dans la définition de scénarios de transition possibles vers des activités touristiques diversifiées que Saint-Colomban pourrait développer été et hiver » (*).
Six mois plus tard, où en est-on ?
Vincent Marcadet, consultant au sein du cabinet Ernst & Young advisory, chargé de cet accompagnement, est venu répondre à cette question au cours d’une réunion publique qui s’est tenue le 18 juillet dernier à la salle des fêtes de Saint-Colomban où 6 tables avaient été disposées pour accueillir chacune 6 à 8 personnes. Une configuration inhabituelle qui a surpris l’assistance (**). M. Marcadet : « On a placé des tables pour vous faire travailler et contribuer. Pour nous, ça nous aide beaucoup car on a un travail objectif à faire à partir de toute la matière de l’ensemble des acteurs économiques. Pour cela, je vous proposerais deux petits exercices afin qu’on puisse ensuite, nous, derrière, utiliser les résultats pour définir différentes orientations. » Cette réunion avait donc un double objectif : restituer le travail effectué et « sonder » la société civile sur les premières hypothèses de diversifications arrêtées.

Cependant, en préambule, Pierre-Yves Bonnivard a rappelé le contexte dans lequel se déroulait cette réunion en remontant à l’hiver 2023-2024 « quand on a eu de gros problèmes d’enneigement sur le domaine skiable avec 57 jours d’ouverture seulement et, encore, sur ces 57 jours a-t-on eu beaucoup de journées en mode dégradé. Par exemple le télésiège de l’Ormet ne servait que d’ascenseur car on ne pouvait pas descendre en ski par la piste qu’il dessert. On était très nombreux, et moi le premier, à n’avoir jamais imaginé qu’on ferme le domaine skiable par manque de neige en plein février. Ce n’était jamais arrivé. Là on a vécu cela. »
Le maire a également annoncé que la commission communale de délégation de service public (DSP) s’était réunie dans l’après-midi et avait constaté qu’aucun exploitant n’avait fait une offre pour la reprise du domaine skiable, la date limite de dépôt des candidatures pour cette DSP lancée le 3 juin était fixée au 15 juillet. Il a précisé que, dans ces conditions, on s’orientait très probablement pour l’hiver 2025-2026 – « mais ce sera au conseil municipal du 1er août de décider » – vers une offre de ski limitée au front de neige avec mise en service du tapis l’ourson et des téléskis de l’Épinette et de Rogemont, donc sans liaison avec les Sybelles. (Revenant sur le refus de la Soremet de présenter une offre (lire ICI), quelqu’un a fait remarquer que cette réponse négative était assortie d’une précision (refus « eu égard aux conditions que vous proposez ») qu’il fallait interpréter, selon lui, comme une volonté de discuter…, encourageant la commune de Saint-Colomban à s’engager « rapidement » dans cette voie.)

Ouvrir le front de neige répondrait à la volonté de « garder un minimum d’offres de ski sur Saint-Colomban-des-Villards dans une période de transition ». « Transition vers quoi ? » a-t-on demandé à Pierre-Yves Bonnivard. « Vers quelque chose qui reste à définir et à acter a répondu le maire. Le projet de téléporté qu’on avait n’est pas enterré mais il faut être très clair, aujourd’hui, il a 10 % de chance aboutir. C’est pas 100, c’est pas 50, c’est 10. On est en train de travailler là-dessus avec notre députée. Mais à partir du moment où on n’a pas le tour de table financier et où, quand même, beaucoup de choses s’alignent contre cet équipement ça va être très, très, très compliqué. Et donc, dans ce climat-là, si on arrive à maintenir une activité d’offres de ski, la question est : qu’est-ce qu’on peut faire en plus ? C’est ça l’objet de la réunion de ce soir. »
Synthèse du diagnostic
Reprenant la parole, M. Marcadet a projeté deux diapositives résumant la situation du domaine skiable et le coût de son fonctionnement :
• la station de ski enregistre une baisse tendancielle de la fréquentation liée à une baisse d’enneigement sur les 2 dernières saisons : baisse du nombre de jours d’ouverture, baisse du nombre de journées skieurs vendues à Saint-Colomban ;
• on a constaté (hiver 23-24) 162 000 passages aux remontées mécaniques dont 31 % au téléski de Cuinat et 20 % au télésiège de Bellard ;
• la station de ski, c’est de 380 000 euros à 1,2 million d’euros de subventions communales chaque année versées au budget annexe des remontées mécaniques ; ce qui représente 11 millions d’euros de déficit cumulé entre 1998 et 2023 (hors dépenses d’investissement), soit 73 333 euros par habitant entre 1998 et 2023 (base 150 habitants), quelque 2 933 euros par habitant et par an depuis 1998 (« Un modèle de stratégie d’attractivité qui n’est plus soutenable financièrement pour les finances communales »).
Toutes ces données sont bien connues. Cependant, leur présentation a été contestée par Stéphane Pezzani car, selon-lui, elles mélangeraient investissements et déficits de fonctionnement. Mais quand, voulant développer son argumentation, ce dernier a demandé à M. Marcadet : « De 98 à 2008, vous savez combien ça a coûté le déficit du domaine skiable ? 0 euro ! », plusieurs personnes dans la salle (dont Jacques Maurino et Gilbert Pautasso) se sont insurgées (« Et tout l’argent versé à Maulin, c’était quoi ? ») provoquant une réaction en chaîne d’objections, répliques et réparties, vite devenue incontrôlable… et peu contrôlée par ceux qui menaient la réunion. Ce qui a coupé court à la discussion ouverte par Stéphane Pezzani car s’en est alors suivi plusieurs minutes d’échanges acerbes que seules les personnes bien informées de l’histoire locale pouvaient éventuellement comprendre… (M. Marcadet avait-il prévu ces débordements ? Il semblerait que oui si l’on en croit l’une des premières diapositives projetées qui recommandait : « j’interagis avec les autres de façon bienveillante et constructive » et « je n’interromps pas les autres »…)
Le calme revenu, M. Marcadet a présenté les « 6 principaux enseignements du diagnostic et des 30 entretiens réalisés » :
• un modèle alpin fragilisé qui nécessite d’engager une transition avec 53 % seulement de fiabilité concernant l’enneigement naturel en 2050 contre 79 % avant 2015 ;
• un domaine relié qui était la principale source d’attractivité de la commune/station et un modèle de stratégie d’attractivité qui n’est plus soutenable financièrement pour les finances communales avec 11 million d’euros de déficit cumulé sur la période couvert par la subvention exceptionnelle ;
• un modèle touristique et économique qui doit se renforcer et se diversifier (avec 1,1 million d’euros environ de chiffres d’affaire généré directement par le ski alpin au profit des socioprofessionnels, hébergeurs compris) ;
• une exploitation du domaine skiable qui grève lourdement le budget de la commune ;
• le village et la station disposent d’atouts à valoriser pour engager une transition touristique (73 % des touristes en Savoie viennent en été pour des activés balades, trail, vélo, « spot fraicheur ») ;
• une indispensable prise en compte des atouts naturels et culturels de la commune dans le futur projet : « Notre vallée concentre une grande diversité d’activités pour lesquelles il est nécessaire de développer l’offre de services. »
Là aussi, rien de vraiment nouveau sauf le chiffre d’affaires généré directement par le ski alpin au profit de l’économie locale (lire encart ci-dessous).
Quelles diversifications pour quel projet ?
Dans le premier exercice (atelier de 30 minutes : 15 de réflexion, 15 de restitution) trois modèles de développement ont été proposés à la réflexion des personnes regroupées autour des tables : arrêt total du ski (modèle 1) ; transition progressive en conservant une offre ski (modèle 2) ; pérennisation du ski alpin sur la base d’un modèle viable et réglementairement acceptable (modèle 3).
Les participants (dont l’un d’entre eux a regretté la moyenne d’âge en s’exclamant : « Où sont les jeunes ? Pourtant c’est pour eux la station ! »), les participants devaient donner des idées de développement et proposer des activités de diversifications de l’offre touristique tout en répondant à ces trois questions : quelle est votre autre station modèle ? ; quelle est votre station repoussoir ? ; avez-vous d’autres exemples et pourquoi ?
Les objectifs et les projets de chaque « table » ont été lus d’où il est ressorti très clairement – et au fond sans surprise – que le modèle 2 a été plébiscité. Ce modèle ou ce scénario d’évolution prévoit « soit une réduction progressive de l’offre de ski alpin en prévision de son arrêt définitif à terme, soit un maintien d’une activité de ski alpin – mais généralement plus circonscrite – et l’engagement d’un plan d’action pour diversifier l’offre ».

Parmi les exemples de diversifications proposés on a relevé : la vallée doit mettre en avant sa différence (histoire, patrimoine), sa position (lieu de passage) et sa proximité avec la vallée de la Maurienne ; il faut davantage de communication et de mise en valeur sur ce qui existe ; développer la glisse (parapente, ski, vélo, VTT) et avoir dans la vallée des structures qui fournissent le matériel adéquat ; avoir des offres pour chaque tranches d’âge ; donner du travail aux habitants ; laisser le télésiège de l’Ormet ouvert ; ne pas oublier les personnes âgées ; ouvrir une maison de retraite ; renouveler l’offre de restauration et en optimiser l’accueil ; créer des hébergements pour les jeunes et les saisonniers ; ouvrir une piste de fond, une luge d’été, un festival de théâtre et de musique, développer le ski de randonnée ; ne pas parler que de Saint-Colomban mais des deux communes ; si les deux communes étaient ensemble elles auraient davantage d’idées ; créer un pôle ski entre les deux communes avec école et sécurisation ; ouvrir un magasin de souvenirs qui pratiquement n’existe pas ; promenade avec des mulets ; location de VTT en relation avec l’ouverture des remontées mécaniques ; encadrement pour les randonnées, la via ferrata ; créer une activité phare (deltaplane, aéromodélisme, concerts, festival…) ; créer des refuges en Belledonne pour les balades en montagne ; ouvrir des espaces culturels, patrimoniaux ou folkloriques ; faciliter la cohabitation entre éleveurs et randonneurs et aménager les sentiers en conséquence ; ouvrir des espaces de coworking, etc.
Sur les idées « repoussoir », la topographie a été citée comme un handicap pour la diversification (difficulté de créer des intinéraires à raquettes en boucle qui évitent les couloirs d’avalanches) ; personne ne souhaite que la station ne devienne une cité dortoir, une station fantôme, ou une station parking comme à Orelle ; l’absence de commerce ; encadrer le ski de randonnée en hiver car Saint-Colomban est attractif et les pratiquants laissent des déchets et des parkings dans un état épouvantable ; le problème des patous ; etc.
À aucun moment il n’a été question du coût et du financement de ces propositions (mais ce n’était peut-être pas le sujet…) qui ont toutes été complétées par la nécessité d’un téléporté. Exemples : « Sans téléporté, sans liaison, on ne voit pas comment on va pouvoir juste avec les pistes de Saint-Colomban s’en sortir. Les gens ne viendront plus et on va en mourir ! » ; « Sur le téléporté, partir du bas pour accéder en haut en toute saison peut, peut-être, encore être pesé. » ; « La liaison est indispensable et obligatoire. » ; etc.
Dans ces conditions, le modèle 2 (« réduction progressive de l’offre de ski alpin en prévision de son arrêt définitif à terme, ou maintien d’une activité de ski alpin plus circonscrite ») est devenu un modèle 3 bis (« pérennisation du ski alpin »)…
Ce qui n’est ni contradictoire ni paradoxal puisque quelques minutes plus tôt dans son préambule le maire avait indiqué : « Cette étude et ce travail viennent en plus du projet qu’on avait et qu’on a encore strictement sur le domaine skiable, projet de téléporté, etc. », et Christian Rochette, vice-président de la 4C, précisé : « Il faut envisager non pas un téléporté classique mais un ascenseur valléen. Ça devient à la mode. Quand j’étais conseiller régional personne ne voulait les aider ni à la région ni au département. Après on a dit : c’est peut-être la solution pour que des villages ou des stations qui sont en bas, en moyenne altitude, puissent aller plus haut pour bénéficier d’un domaine skiable à portée de remontée. Qui va financer cela ? Ce n’est pas la commune. Donc il faut monter au créneau, il faut se faire aider par les élus sur le territoire, notamment notre députée, pour que la région finance très largement ce projet. »
M. Rochette a également indiqué, et c’est apparu comme un revirement dans la politique touristique de la 4C, « qu’à un moment, puisque la 4C a la compétence tourisme, il faudra, pourquoi pas, associer notre communauté de communes au développement et à l’accompagnement des Villards ».
« Les Villards, un pari réussi »
Dans le second atelier proposé, l’auditoire était invité à répondre à cette question : « Saint-Colomban-des-Villards fait la une du Dauphiné libéré dans 5 ans, le 15 décembre 2030 : quel est le titre de cette une ? »
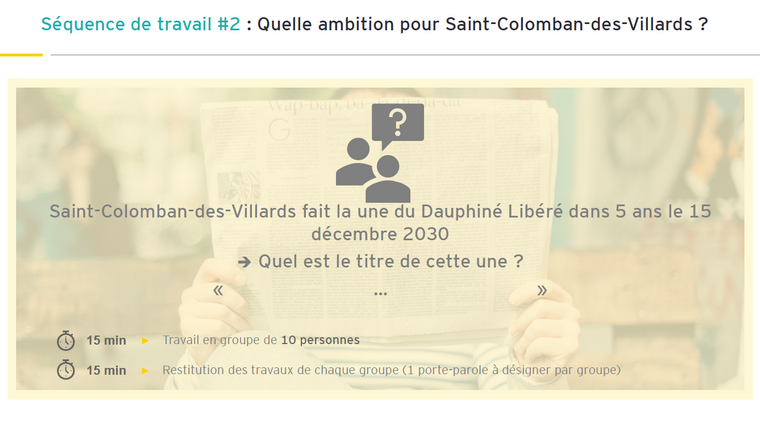
Tous les titres trouvés traduisent un inébranlable optimisme : Les Villards, un pari réussi ; Saint-Colomban-des-Villards : un bel exemple d’ascension ; Saint-Colomban-des-Villards : ascenseur pour le ski haut ; Renaissance d’un village ; On a sauvé Saint-Col ; Saint-Col, un village qui ne dort jamais ; L’ascenseur valléen fait son plein dès l’ouverture de la station. Trois titres ont été particulièrement applaudis : À Saint-Colomban-des-Villards : tous les pensionnaires de l’Ehpad sont centenaires, et : Avec une affluence record depuis 5 ans et malgré un enterrement programmé, Saint-Col n’est pas mort ! Ce dernier titre faisant écho à ce qu’entonnaient les jeunes villarins après l’avalanche de 1981 : « Non, Non, Non, Saint-Col ne périra pas ! »
Fort de ces contributions et de ces suggestions, le cabinet Ernst & Young advisory doit rédiger une synthèse qui sera dévoilée aux conseillers municipaux de Saint-Colomban-des-Villards le 25 juillet au cours d’une réunion à laquelle seront invités la sous-préfète, la 4C, le Sivav et Jacqueline Dupenloup.
______________________________________________
(*) Cette étude est financée par l’État (61 800 euros TTC, correspondant à « 56 jours de travail »).↩︎
(**) Outre l’intervenant M. Marcadet, consultant au sein du cabinet Ernst & Young advisory, étaient présents des élus de la commune de Saint-Colomban-des-Villards : Pierre-Yves Bonnivard (maire), Christian Frasson-Botton et Christine Reffet (adjoints au maire), Valérie Favre-Teylaz, Stéphanie Lafaury, Marie-Thérèse Ledain, Bernard Wyns (conseillers municipaux), Jacqueline Dupenloup, maire de Saint-Alban-des-Villards, Christian Rochette, maire de Saint-Rémy-de-Maurienne, vice-président de la 4C, et quelque 80 personnes (dont Maurice Bozon, ancien maire de Saint-Colomban-des-Villards).↩︎
■ Les photos sont de Christophe Mayoux, la « Une » et le dernier document du cabinet Ernst & Young.
Le ski : quelles retombée économiques ?
Selon la Cour des comptes, « la modalité de calcul des retombées économiques du ski sur l’économie locale », souvent mises en avant pour justifier les investissements dans le ski, « est insuffisamment documentée ». Un ratio « un pour six » est généralement présenté : un euro dépensé dans un forfait de remontées mécaniques générerait six euros de retombées sur l’économie locale dans la location du matériel, les transports, les commerces, les bars, les cours de ski, le logement, etc. (*)
Quel est ce ratio à Saint-Colomban-des-Villards ?
Une donnée contenue dans une des diapositives projetées par M. Marcadet, permet de l’évaluer (**). Il s’agit du chiffre d’affaires (CA) « généré directement par le ski alpin au profit des socioprofessionnels, hébergeurs compris ». Citant la société Savoie stations domaines skiables (SSDS) comme source, ce CA serait de l’ordre de 1,1 million d’euros HT dont 50 % proviendraient des activités des hébergeurs (soit Goélia, à La Pierre, et Olydéa, à La Perrière, puisque À la Croisée des chemins ne paient pas totalement ses loyers).
Si on considère que le CA moyen d’une saison de ski à Saint-Colomban est de l’ordre de 600 000 euros HT, on en déduit que 1 euro dépensé aux caisses des remontées mécaniques génèrerait 1,8 euro de CA dans la station. Soit trois fois moins que la « norme ».
Ce ratio est encore moins bon si on ne prend pas en compte dans son calcul la contribution des hébergeurs (Goélia et Olydéa) dans la mesure où leur CA n’est pas ou peu dépensé aux Villards. Dans ce cas de figure, 1 euro dépensé aux caisses des remontées mécaniques ne génère que 0,9 € dans la station…
Sur une année moyenne, la commune verse une subvention de 800 000 euros au budget annexe des remontées mécaniques. Quand les touristes apportent 1 euro aux caisses des remontées mécaniques, la commune doit donc ajouter dans ces caisses 1,3 euro supplémentaire pour que ça tourne. En somme, il faut mettre 2,3 euros dans le fonctionnement des remontées mécaniques (dont 60 % d’argent public) pour que les socioprofessionnels en tirent 1 euro d’activité économique.↩︎
________________________________________________________
(*) Chiffre mentionné par Domaines skiables de France dans son recueil des indicateurs et analyses (2022) et repris dans le rapport de la Cour des comptes : « Les stations de montagne face au changement climatique » (rapport public thématique ; février 2024).↩︎
(**) Diapositive 8 (« Nos 6 principaux enseignements du diagnostic et des 30 entretiens »).↩︎
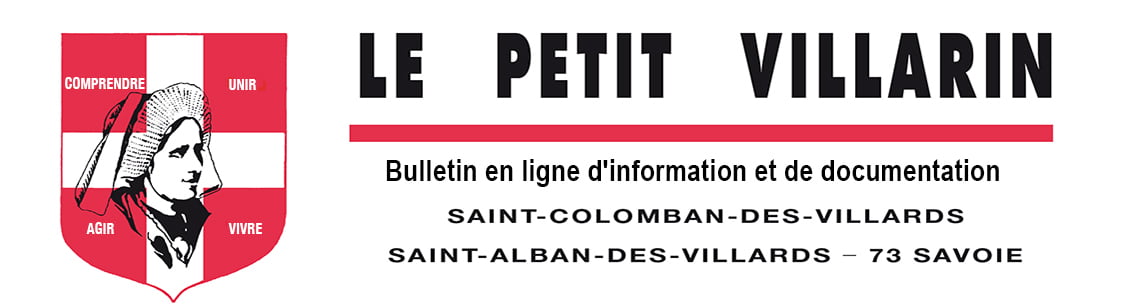
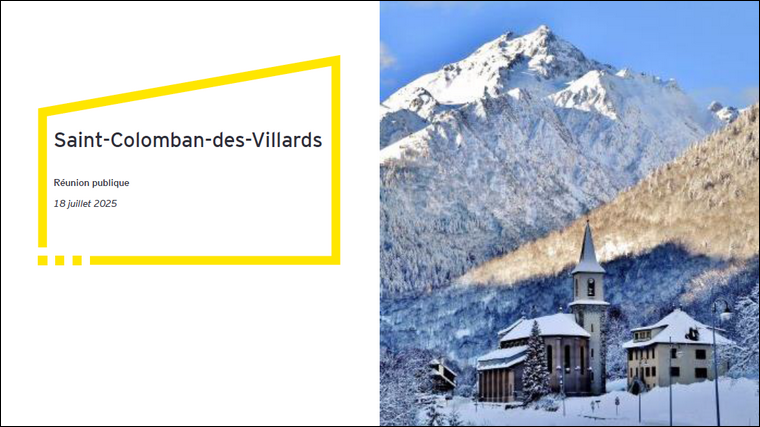



Très utilisateur de la station depuis l’aventure Sybelles (travail remarquable de Maurice Bozon), je regrette de n’avoir pu assister à cette réunion qui a très bien synthétisé le problème.
Je me permets d’apporter une modeste contribution au débat : il me semblerait raisonnable d’étudier une petite prolongation du téléski du Coin, avec passage en souterrain sous la piste venant du télésiège, ce qui permettrait de le rejoindre pour achever la descente, prolongeant ainsi la saison de peut-être deux semaines, ceci à moindre frais (Je n’ai jamais compris la suppression du téléski du Coin, qui précisément l’autorisait, ouvrant en plus une très jolie petite piste de descente).
Merci pour cet excellent article et reflexion sur un sujet qui malheureusement va concerner bon nombre de nos villages.
J’enrage quand je lis ces comptes rendus, celui ci, et ceux d’avant, sur la station ou sur les dégâts de Lachal, on ne peut que constater que tout est pris en considération quand on est au pied du mur, voire pire au bord du gouffre, le tourisme d’été existe peu dans les grands domaines, pas du tout dans les petits villages de montagne, baladez vous dans les Villards tout est sans vie, la montagne ne peut vivre qu’avec le ski, les restant malgré toutes les réunions organisées n’aboutira à rien.
Sans le ski des Sybelles St Colomban n’a pas d’avenir
Faut-il une nouvelle équipe dirigeante ?